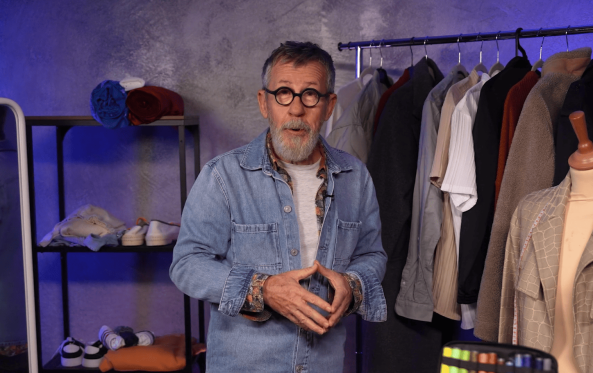
Convaincre mes collaborateurs
Porteurs : RSE Partenaires : tous les services de l'entreprise

Contexte et description
Résolument transversale, une démarche d’éco-conception repose sur l’implication de l’ensemble des services de l’organisation qui la mène.
Le succès de cette démarche dépend de la capacité à engager les parties prenantes, de manière volontaire, en partageant avec chacune les enjeux et l’intérêt de s’y inscrire.
Chaque collaborateur, chaque service possède sa propre dynamique d’engagement et sera sensible et/ou réfractaire à des arguments différents.
C’est pourquoi convaincre sa direction et ses collaborateurs peut s’avérer long et délicat, parfois déroutant et décourageant.
Dans ce contexte, il est essentiel d’entamer cette démarche le plus tôt possible et de maintenir son effort dans le temps afin d’amener l’éco-conception dans l’organisation durablement et avec succès.
Mise en oeuvre
Difficile
Complexité de mise en oeuvre
Faible
Gain économique estimé
Faible
Moyens humains
6 mois 1 saison
Délais de mise en oeuvre
Étapes de mise en œuvre
Maintenant c'est à vous de jouer : suivez la fiche pas à pas pour passer à l'action !
1
Renforcer ses connaissances (Cf. Anti-sèche : Comprendre ce qu'est une démarche d'éco-conception) pour mieux appréhender l’éco-conception et disposer de premiers éléments de sensibilisation (définition, enjeux, approches...).
2
Lister les bénéfices que l’éco-conception peut apporter à l’organisation et les illustrer avec des retours d’expériences d’organisations ayant un modèle économique proche.
3
Identifier les parties prenantes prioritaires : quels sont les acteurs qui sont concernés par la mise en place de l’éco-conception ?
Quel est leur périmètre de responsabilité ?
Quels sont leurs objectifs annuels ? Quels sont leurs connaissances des enjeux sociaux-environnementaux de la filière ?
Sur quoi ont-ils réellement la main (quels leviers d'actions) ?
Hiérarchiser ces acteurs selon leur capacité d’influer sur la réussite du projet et leur intérêt à s’y engager. Il est possible de cartographier ces parties prenantes par une « matrice intérêt influence ». Par ailleurs, il est essentiel que ces parties prenantes aient du temps alloué pour penser puis déployer la démarche.
4
Insuffler l’adhésion en partant du besoin interne : pour les parties prenantes prioritaires, identifier les volontaires sur lesquels il est possible de s’appuyer pour la démarche.
Il est aussi important de comprendre leur métier, leurs priorités et leurs préoccupations, l’objectif étant de les faire converger, d’ouvrir de nouveaux territoires d’expérimentation.
Les outils de conduite du changement tels que « la carte des partenaires » peuvent être utiles à cette étape.
5
Identifier les freins et les opportunités : en se basant sur la carte des partenaires, lister les principales objections et avantages (entendus ou supposés) à s’engager dans une démarche d’éco-conception.
6
Identifier d’éventuelles actions d’éco-conception déjà en place dans l’organisation.
Il n’est pas exclu que des actions d’éco-conception aient déjà été développées, mais non valorisées. Si c’est le cas, cet argument peut être utilisé pour démontrer la capacité de l’organisation à mettre en place de telles actions.
Il serait alors intéressant de partager le retour d’expérience (ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, ce qu'il faudrait changer si on souhaitait reconduire une action du même type ...).
7
Se renseigner sur le contexte actuel : attentes de la clientèle et cadre réglementaire et concurrentiel.
Ces éléments peuvent en effet inciter certains services à se positionner sur une démarche d’éco-conception.
Pour cela, il peut être utile de faire des recherches sur les législations environnementales françaises et européennes, en place et à venir et de consulter des sondages de consommateurs.
8
Préparer un argumentaire : pour chacune des objections identifiées, lister les parades en s’attachant à développer des arguments logiques/rationnels (statistiques, chiffres, références, démonstrations, processus…) et créatifs/émotionnels (histoire, imagination, analogie…).
9
Construire la « stratégie d’adhésion » : pour chaque typologie de partie prenante, identifier quelles actions de sensibilisation sont les plus appropriées et les ventiler dans le temps.
L’objectif est que l’environnement de l’organisation s’imprègne du sujet de l’éco-conception.
Tous les moyens sont bons : formels (newsletters, veilles, retours d’expériences…) ou informels (boîte à idées, « ice-breaker » en réunion, discussions autour d’un café…).
10
Proposer une ou plusieurs réunions avec la direction et un responsable ou représentant de chaque service pour les convaincre de se lancer dans une démarche d’éco-conception grâce aux éléments identifiés dans les étapes précédentes.
Définir ensemble un plan d’action succinct (Cf. Fiche A vous de jouer : Piloter ma démarche éco-conception).
Indicateurs clés
-
Formalisation d’un argumentaire.
-
Niveau de compréhension et d’adhésion à l’éco-conception.
Point de vigilance
L’adhésion à la démarche n’est jamais définitivement acquise, tout peut être à recommencer si les interlocuteurs changent.
L’objectif est de faire vivre une culture de l’éco-conception, inscrite dans le temps au sein de l’organisation.
Pour aller plus loin
Ils l’ont fait

Corail : La basket Marseille 21
"Faute d’avoir trouvé une filière d’approvisionnement en bouteilles plastique usagées qui nous convenait, nous l’avons créée. "
Circle Sportswear : Le t-shirt Challenge en collaboration avec Saint James

Close To Clothes : Labelling créatif et engagé
Produits sur mesure éco-conçus et sourcing certifié.

Camif Edition : décloisonner pour mieux produire
Pour continuer de recevoir des ressources et actualités autour de l'éco-conception
Votre inscription a bien été prise en compte
Merci pour votre confiance



